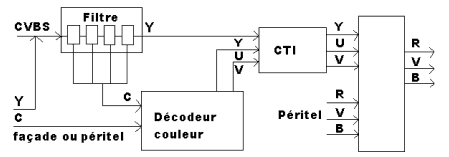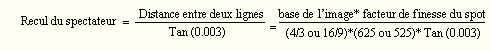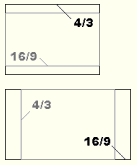|
|
||
|
L'image du HOME-CINEMA
1.
LES DIFF?RENTES MANI?RES DE STOCKER
UNE IMAGE.
1.1. Les 4 formats. 2. STANDARDS
D'ENREGISTREMENT. 2.1. Le NTSC.
4. TAILLE
DE L'IMAGE N?CESSAIRE. 4.1. Le crit?re THX. 5. LES
DIFF?RENTES QUALIT?S D'UNE IMAGE. 5.1. Le rapport signal/bruit. 6. LES
DIFF?RENTES TECHNOLOGIES DE DIFFUSEUR VID?O. 6.1. Les t?l?viseurs.
Nous allons traiter d?sormais la partie vid?o de nos installations home-cinema. Nous avons ? notre disposition 3 sources vid?o : le magn?toscope VHS, le lecteur de laserdisc et le lecteur de DVD. Ces trois sources ont de nombreuses diff?rences. Auparavant, rappelons les diff?rentes mani?res de stocker une image.
1. Les diff?rentes mani?res de stocker une image.
Une image telle qu'on peut la voir est le r?sultat d'une ?mission de lumi?re. Cette lumi?re est en fait compos?e d'une multitude d'ondes lumineuses avec de nombreuses fr?quences m?lang?es ce qui en fait une information particuli?rement complexe ? g?rer. Ce ph?nom?ne analogique peut ?tre fig? de mani?re analogique comme sur une pellicule photo ou une pellicule cin?ma. Ou bien elle peut ?tre transform?e en signal ?lectrique pour nos appareils vid?o. Pour ce faire on utilise une technique appel?e t?l?cin?ma. 3 capteurs, rouge, vert et bleu vont filmer la lumi?re issue de la pellicule qui d?file juste devant eux tout comme le ferait une cam?ra vid?o triCCD. Le signal est alors RVB. N?anmoins ce format de vid?o est d?licat ? stocker et ? travailler en raison de son importante r?solution. Il n'est donc utilis? que dans le transport direct de l'image comme pour le cas d'une carte graphique qui envoie directement et sans stockage l'image ? un moniteur informatique. D?s que l'on cherche ? stocker des images, un autre proc?d? de stockage appel? YUV ou encore composante est alors utilis?. La diff?rence avec le RVB se r?sume en une image noir et blanc sur laquelle on vient greffer deux images bas?es sur les couleurs principales. Si on veut un format de stockage encore plus ?conome en place on utilise le format appel? Y/C ou encore S-vid?o. L'image est alors compos?e d'une image en noir et blanc et d'une image qui porte les couleurs. La premi?re est appel?e luminance la deuxi?me est appel?e chrominance. Si on doit encore condenser l'image on m?langera la luminance et la chrominance pour obtenir un format appel? CVBS ou encore composite.
Apr?s ce bref r?capitulatif voyons dans quel type d'appareil ces diff?rents formats sont utilis?s. Le RVB est surtout utilis? en informatique. La r?solution atteint 800 points par ligne. Dans cette configuration, le RVB est enrichi de signaux appel?s synchro horizontale et synchro verticale, quelquefois appel?s "RVB pro" (il faut alors 5 conducteurs plus 1 masse). La connectique utilis?e est principalement sur fiches BNC. Pour la vid?o domestique, c'est une prise P?ritel qui est utilis?e ( appel?e aussi prise SCART). Dans ce cas, les deux signaux de synchronisation sont m?lang?s au signal de vert (il faut alors 3 conducteurs plus 1 masse). Le YUV est utilis? dans toutes les machines vid?os professionnelles comme les magn?toscopes BETACAM ou encore les magn?toscopes DV et bien sur, sur les lecteurs de DVD. La r?solution atteint 600 points par ligne pour un lecteur de DVD. Sur ces trois types de machines, l'information ?tant enregistr?e en YUV, elle peut ?tre restitu?e en l'?tat. N?anmoins certains magn?toscopes DV et certains lecteurs de DVD ne proposent pas la connectique pour le r?cup?rer directement. Remarque : suivant que le YUV est restitu? de mani?re analogique ou num?rique, il peut se d?signer par l'appellation Y-Pb-Pr ou Y-Cb-Cr. La connectique est constitu?e de fiches cinch ou BNC (il faut alors 3 conducteurs plus 1 masse). Le Y/C est utilis? dans les magn?toscopes S-VHS et HI-8. La r?solution atteint 400 points par ligne pour un magn?toscope S-VHS. La connectique utilis?e est une prise nomm?e " Ushiden " ou encore " mini-DIN 4 broches " (il faut alors 2 conducteurs plus 1 masse). Lorsque cette prise est pr?sente sur nos lecteurs DVD, le signal qui en sort r?sulte d'un appauvrissement du signal YUV originel. Le CVBS est utilis? dans tous les magn?toscopes VHS, la r?ception hertzienne et le laserdisc. La r?solution atteint 240 points par ligne pour un magn?toscope VHS. Quand un lecteur de laserdisc poss?de une sortie RVB ou Y/C, cela ne veut pas dire que l'image a ?t? enregistr?e sous ce format. De m?me les lecteurs de DVD poss?dent tous une sortie composite qui r?sulte de l'addition de la luminance et de la chrominance.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'image vid?o sera toujours finalement convertie en RVB, que ce soit dans un t?l?viseur o? il existe trois faisceaux d'?lectrons distincts ou encore dans un projecteur tri-tubes ou m?me un projecteur LCD. Dans l'absolu, il faudrait pour une meilleure qualit? d'image n'utiliser que le RVB. Mais, mis ? part lors d'un direct sur les plateaux de TV , nous sommes oblig?s d'utiliser au minimum le YUV. Voil? pourquoi ce type de sortie est tant pl?biscit?. Et chose tr?s importante, c'est que tout t?l?viseur, m?me s'il ne poss?de qu'une entr?e composite et qu'il ne co?te que 1000 francs, travaille ? l'int?rieur en composite puis Y/C puis en YUV et finalement en RVB. Quand un t?l?viseur re?oit un signal composite, il filtre la couleur de la lumi?re. Suivant le standard (PAL,NTSC?), la fr?quence de filtrage diff?re. Puis la chrominance rentre dans un circuit de s?paration de la couleur. C'est ici que la couleur est transform?e en deux signaux R-Y et B-Y (respectivement le U et le V de YUV). Suivant le standard, c'est cette puce qui devra utiliser des algorithmes diff?rents. A partir de cette endroit, le NTSC et le PAL ne diff?rent plus que par le nombre d'images par secondes. Puis suivant les t?l?viseurs, une puce d'am?lioration de l'image (le CTI) est pr?sente. Finalement, un dernier composant transforme le YUV en RVB et l'envoie au tube cathodique. C'est dans ce dernier, que les signaux RVB provenant directement de la p?ritel peuvent ?tre ins?rer. Il est donc normal que si votre diffuseur n'acceptent pas du NTSC en composite ou Y/C, il l'accepte bien volontiers en RVB.
Donc quand vous avez un diffuseur et un DVD qui vous laisse le choix entre YUV et RVB, le choix se ferra suivant les circuits utilis?s dans le lecteur et la pr?sence ou non du CTI dans le diffuseur. D'autre part, certains types d'appareils ont leur processeur vid?o qui fonctionne en YUV. L'entr?e RVB est alors convertie en YUV et sera projet? finalement en RVB (cas par exemple de l'?cran plasma de chez Thomson). Dans ce cas, l'entr?e RVB n'a m?me pas lieu d'?tre utilis?e pour un possesseur de DVD. Pour l'anecdote, sur un t?l?viseur 4/3 uniquement PAL avec pour seule entr?e une composite, j'ai apport? des modification qui permettent d?j? une commutation 16/9?me manuelle, une entr?e Y/C, et en cours de mise au point, une entr?e YUV qui prend bien sur le NTSC de mes DVDs zone 1. 2. Standards d'enregistrement. D'un pays ? l'autre, diff?rents standards d'enregistrements sont utilis?s : le NTSC, le PAL, le SECAM et le MESECAM.
Le NTSC est un standard bas? sur 525 lignes et sur 30 images par seconde. D'autre part il existe 2 formats de NTSC : le NTSC 3.58 et le NTSC 4 .43 . Le chiffre se r?f?re ? la fr?quence en m?gahertz de la sous-porteuse vid?o. Suivant l'anciennet? de votre diffuseur, il peut ne pas les diffuser, ne diffuser que le NTSC 4.43 (car le PAL est aussi en 4 .43) ou tout diffuser. Il est utilis? aux Etats-Unis et au Japon.
Le PAL est bas? sur 625 lignes et sur 25 images par seconde. Il est utilis? dans tous les pays europ?ens sauf la France qui utilise le SECAM pour ses diffusions hertzienne. N?anmoins tous les p?riph?riques vid?o tel que cam?scope, console de jeu, lecteur de laserdisc et de DVD sont en PAL. La qualit? de l'image PAL par rapport ? son homologue NTSC n'est pas mauvaise. Si lors de d?monstration, on utilise souvent du NTSC, cela tient souvent au fait que les titres sortent d'abord en zone 1, et qu'? l'?poque du laserdisc, les masters am?ricains ?taient souvent plus soign?s.
Le SECAM est utilis? les diffusions hertziennes en France et en Russie. Le MESECAM est une variante utilis? en Afrique du nord. Une image vid?o est en fait constitu? de 2 trames dont l'une affiche toutes les lignes paires et l'autre toutes les lignes impaires. C'est pour cela, que lors du d?placement d'un objet dans le sens horizontal, vous voyez les bords gauches et droits hachur?s. D?s lors que l'objet est immobile, les 2 trames se combinent et les bords deviennent nets. Autrement dit la r?solution est de 625 lignes lorsque l'image est immobile (la r?manence de l'?il entrant en jeu), mais elle n'est que de 310 lignes lorsque l'image est en mouvement. Rappelons ?galement que le nombres de lignes horizontales ne d?pend que du balayage conditionn? par le standard d'enregistrement (625 ou 525 lignes). C'est suivant la source et le type de connectique utilis? que le nombre de lignes verticales affichables distinctement va varier entre 240 et 600 (ou points par ligne horizontale).
Enfin, ce qui est bon ? savoir, c'est que sur un disque DVD, une image Pal est constitu? de 720*576 pixels et une image NTSC 720*480 pixels. Aucune de cette r?solution n'est au format 4/3 !
Vous aurez remarqu? qu'une seconde de PAL est aussi volumineux qu'une seconde de NTSC. Si le PAL est un format de 625 lignes, et que le DVD fournit une image de 576 seulement, c'est pour la raison suivante : quand une premi?re trame vient d'?tre affich?e, le temps de retour du spot en haut de l'?cran dure 25 lignes environs. Donc pour une image, il y a 49 lignes qui ne sont pas affich?s. Pour le NTSC, il en est de m?me.
On parle beaucoup des futurs DVD ? sorties progressives. C'est ? dire qu'? la sortie YUV, l'image vid?o sera restituée par 2 trames strictement identiques. Toutes les lignes seront affich?es simultan?ment. L'effet est directement comparable ? un doubleur de lignes avec ? la clef une r?solution doubl?e. De plus cette solution sera encore plus proche de l'image tel qu'elle est stock?e sur le DVD. Si les lecteurs de salons ne sont pas encore sortis, ou alors ? des prix inabordables, des cartes informatiques en sont d?j? capables, et ce, pour un prix ? peine sup?rieur ? une carte graphique ?volu?e. Pour exploiter celle-ci, il faut un diffuseur qui supporte les fr?quences de balayages sup?rieures ou ?gales ? 31kHz. Autrement dit, le SONY FD1 pour les t?l?viseurs ou les vid?oprojecteurs compatible informatique (ou ?data ?).
3.3. Pour ce qui est de la PLAYSTATION 1. L'int?r?t que certains portent aux r?solutions vid?o me pousse ? en parler quand m?me. La Playstation est une source de vid?o progressive que l'on ignore souvent. De plus la gestion du PAL vis ? vis du NTSC est tr?s int?ressante.
Le PAL : c'est 625 lignes dont 576 affichables (les 49 derni?res servent au retour du spot jusqu'en haut de l'?cran). Pour la vid?o, les 625 lignes sont affich?es en deux fois ; les paires et les impaires. On appelle cela un balayage entrelac?. 25 images par secondes en 2 demi-images = 50 Hz. Le NTSC : c'est 525 lignes dont 480 affichables (les 45 derni?res servent au retour du spot jusqu'en haut de l'?cran). Pour la vid?o, les 525 lignes sont affich?es en deux fois ; les paires et impaires. On appelle cela un balayage entrelac?. 30 images par secondes en 2 demi-images = 60 Hz
Le classique : 272 lignes non entrelacé en 25 ou 30 images seconde. Pour que cela ressemble ? de la vid?o, la PSX envoie deux fois l'image identique. La haute r?solution en 272 en 50 ou 60 images par seconde. C'est toujours du non entrelac?, les lignes se superpose parfaitement. Mais les travelling sont nets (mode haute r?solution des circuits prototypes de WIPE OUT 3 ou dans GRAN TURISMO les circuit HiFi). La haute r?solution bis est de 25 images par seconde ? 576 lignes, identique ? un signal vid?o classique (page d'accueil avec le logo qui scintille). Pour disposer du 272 lignes sur du PAL, 576/2-272=16 lignes noires d'o? des bandes noires en haut et bas. Pour disposer du 272 lignes sur du NTSC, 480/2-272=-32 lignes d'o? une image tronqu?e en haut et bas
Pour ce qui est de la vitesse, WIPE OUT 3 est calcul? en 272 lignes environ avec une cadence de 30 images/s (basse r?solution). Si on choisit PAL il va rajouter une pause entre chaque image pour les cadencer ? 25 images/s. La ou c'est rigolo, c'est que le compte ? rebours de 30 secondes fait 30 secondes en Pal et 25 secondes en NTSC ! On fait donc le m?me temps en chiffre mais pas en temps (blague !).Jouez en NTSC revient ? jouez 20% plus vite. CQFD. D'o? l'impression r?elle de rapidit?, et le braquage plus intempestif en NTSC qu'en PAL. 3.4. Diff?rence entre format cin?ma et format vid?o. Quand un r?alisateur d?cide de tourner un nouveau film, il va choisir le format cin?ma de l'image. Les grandes productions Hollywoodiennes sont r?alis?es principalement au format 2.35 cin?mascope et 1.85. Dans un cin?ma, l'?cran est aux proportions 2.35 ? 1 : c'est-?-dire que la longueur de l'?cran est 2.35 fois plus grande que la hauteur. Si le film est enregistr? en 2.35 (Contact par exemple), l'?cran sera enti?rement recouvert par l'image. Si le film est en 1.85 (Daylight par exemple), l'?cran pr?sentera 2 bandes noires sur les c?t?s gauche et droit. Elles seront d'autant plus grandes si le film est enregistr? en 1.77 ou 1.33 (Le projet Blair witch par exemple). Pour ce qui est du format vid?o, il est toujours de 4/3 (1.33). Si on veut faire tenir un film au format cin?mascope sur un support vid?o il y aura 2 choix possibles. Soit on recadre le film, en choisissant dans l'image 2.35, la partie la plus int?ressante de mani?re ? remplir un ?cran 4/3, on exploite alors ? fond la r?solution du diffuseur vid?o mais on perd une multitude de d?tails du film voir l'ambiance m?me (dans Twister on ne voit qu'une demi-tornade ? la fois...). Soit on ins?re 2 bandes noires en haut et en bas de l'image, le film est dit en format cin?ma respect?. On a alors le droit ? l'int?gralit? de l'image originale. En contrepartie on n'utilise pas toute la surface du diffuseur vid?o. 3.5. Le 16/9 anamorphique. Un des gros atouts du DVD est de pouvoir g?rer une image en 16/9 anamorphique ; c'est-?-dire, sur une image 4/3, on enregistre une image ?tir?e dans le sens de la hauteur, qui sera ensuite comprim?e lors de la restitution. En fait, c'est une astuce qui utilise le r?le inutile des bandes noires. Le principe est le suivant : si l'image est au format 1.77, on la d?forme de mani?re ? remplir compl?tement l'image 4/3. C'est ensuite votre t?l?viseur ou votre projecteur qui ? l'aide de sa commutation 16/9, va restaurer les proportions originelles de l'image. L'int?r?t de l'op?ration est d'augmenter la r?solution verticale de 33%. Concr?tement une image au 2.35 cin?mascope remplit 52% d'un ?cran 4/3. Elle utilise donc 0.52 x 625 lignes = 325 lignes, le reste des lignes d?crivant les bandes noires. Si cette m?me image est enregistr?e en 16/9 anamorphique, alors 470 lignes seront utilis?es pour le film. Conclusion, une image en 16/9 anamorphique pr?sente un lignage bien moins perceptible, limite les effets d'escaliers sur les contours obliques de l'image, augmente la luminosit? et diminue le besoin d'un doubleur de ligne (qui lui augmente de 100% le nombre de lignes affich?es).
Voici le tableau qui donne le pourcentage de pixels utilis?s pour les diff?rents formats cin?mas et la nature de l'enregistrement vid?o. Un documentaire de 1 heure en 4/3 prend autant de place que 1h45 d'un film en 2.35 cin?mascope.
N?anmoins, pour revenir au fait que Titanic soit enregistr? en format vid?o 4/3 (ce qui est un vrai affront ? tout les possesseurs de machines compatibles 16/9) et que leurs g?niteurs avancent que le film ?tait trop long, Das Boot leur prouve le contraire. Sur un DVD double couche ?galement, il dure 10 minutes de plus et il est enregistr? en 16/9?me au format cin?ma 1.66 environ, ce qui est 35% plus gros qu'un Titanic qui aurait ?t? en 16/9?me 2.35. Et encore, il y a deux pistes DOLBY DIGITAL 5.1 au lieu de une sur le titre de la Fox. Il y a des claques qui se perdent... On peut d?s lors voir le probl?me autrement. Comme une image de DVD est compress?e, image par image, plan par plan parfois, un film 2.35 risque moins de pr?senter des signes de compression outrageuse qu'un film en 1.85. On reproche parfois aux arri?res plans des images du DVD de manquer de profondeur ou de vie.
3.7. Le proc?d? MACROVION. Ce proc?d? a pour but d'emp?cher la duplication d'un programme vid?o et par ce biais, emp?cher la vente de cassettes pirates qui d?cevront le particulier par leur qualit? moindre. Il rajoute un signal dans l'image pour tromper l'ajustement automatique du niveau d'enregistrement de la vid?o des magn?toscopes. Dans les lignes qui sont en dehors de l'?cran, il ins?re des signaux ultralumineux, le magn?toscope le percevant, il r?duit le niveau global de la vid?o, ce qui assombrit alors l'image. Le probl?me, c'est que certains t?l?viseurs ou vid?oprojecteurs y sont sensibles alors qu'ils sont sens?s ne pas contenir d'ajustement de niveau. Il reste alors 2 solutions suivant les sources pour que notre installation n'en souffre pas. Pour les magn?toscopes qui lisent une cassette prot?g?e, il reste ? utiliser un bo?tier qui filtre les signaux MACROVISION. On peut en trouver chez Conrad ?lectronic par exemple (309 FTT r?f : 0353 990-14).Ou le construire en recherchant des plans sur Internet. Pour les lecteurs de DVD, les 4 types de signaux sont susceptibles d'?tre pollu?s. Et si le RVB est atteint, il faut alors 3 filtres MACROVISION. Le plus simple est d'alors acheter un lecteur dont la fonction MACROVISION est inhib?e. En effet, le disque n'est pas encod? avec les signaux parasites. Il contient juste une information qui active un circuit dans le lecteur. Pour certains lecteurs, il est donc possible de supprimer l'action de celui. Au d?but sur certains lecteurs, il suffisait de souder un fil entre deux points. Maintenant certains sont vendus avec la mention MACRO-off alors qu'aucune modification n'a ?t? op?r?e. Tant que l'utilisateur n'essaye pas de faire de copie, il ne s'apercevra de rien car peu de diffuseurs y sont vraiment sensibles. Dernier point, les ?diteurs doivent payer un droit ? MACROVISION pour activer le circuit qui dispose de 3 niveaux de protections. Ainsi, sur certains disques, les perturbations de l'image seront plus ou moins grandes. Et sur d'autres, la fonction n'est pas activ?e comme pour Demain ne meurt jamais.
3.8. La synchronisation. En parlant de synchronisation, on fait allusion aux signaux qui permettent une image stable dans le cadre du t?l?viseur. En effet une source envoie un flot d'image, et la TV doit savoir ou se trouve le haut et la gauche de chaque image. Si on observe l'information vid?o composite en continue, on verra des signaux de type cr?neaux pendant le temps de 25 lignes pour dire "voici le haut de l'image, les 288 lignes suivantes vont ?tre les impaires", suivent alors 288 lignes toutes s?par?es par un top qui dit "retour ? la ligne". Ensuite on verra des signaux en cr?neaux pendant le temps de 25 lignes pour dire "voici le haut de l'image, les 288 lignes suivantes vont ?tre les paires". Et bien sur suivent les 288 lignes paires suivant la m?me structure que les impaires. Le RVB peut voir ces signaux de synchronisation horizontale et de synchronisation verticale ?tre v?hicul?s s?par?ment. Cette sp?cificit? est quelquefois appel?e "RVB pro" (il faut alors 5 conducteurs plus 1 masse). La connectique utilis?e est principalement sur fiches BNC ou DB15. Pour la vid?o domestique, c'est une prise P?ritel qui est utilis?e (originellement appel?e SCART). Dans ce cas, les deux signaux de synchronisation sont m?lang?s pour n'en former plus qu'un seul (il faut alors 4 conducteurs plus 1 masse). C'est ce que l'on appelle le RVBS, le S d?signant la synchro composite. Il arrive aussi que le signal de synchronisation soit m?lang? au vert, ? la mani?re de la vid?o composite. On a alors du RVsB. Mais, rassurer vous, ces diff?rentes mani?res de v?hiculer les signaux de synchronisation ne se traduisent pas par des ?carts de qualit?s perceptibles. Maintenant, pour ce qui est du branchement d'un vid?oprojecteur, ? un ordinateur ou ? un lecteur de DVD, plusieurs cas sont envisageables. La gestion des synchro est identique sur la source et le diffuseur, pas de probl?me ?videmment. Si le projecteur a une entr?e RVBHV, et le DVD une RVBS alors il se trouve que 95 % des diffuseurs qui r?clament une synchro Horizontale se satisfassent d'une synchro composite. Par contre la s?paration de la synchro verticale de la synchro composite n?cessite un circuit ?lectronique mineur. Si la source est un ordinateur et qu'il sort un signal en RVBHV, le branchement sur diffuseur RVBS a des chances de fonctionner en branchant la synchro horizontale sur l'entr?e synchro composite.
3.9.1. La Fr?quence verticale. La fr?quence verticale d?signe le nombre de retour du spot en une seconde en haut de l'image. Sur de la vid?o 50 Hz, et bien la fr?quence verticale est de 50 Hz (25 images restitu?es en 2 passes). En NTSC, elle est de 60 Hz. Ces choix ont ?t? faits pour la correspondance avec le r?seau ?lectrique locale pour minimiser les probl?mes d'interf?rences avec l'?clairage artificiel. En mode progressif, la fr?quence verticale est inchang?e, en mode doublage de trame, on obtient 100Hz et 120 Hz par extension au NTSC.
La fr?quence horizontale d?signe le nombre de retour du spot en une seconde ? gauche de l'image. Nous connaissons la fr?quence verticale qui donne le nombre de demi-images par seconde (demi-image = trame). Ces demi-images sont constitu?s de 625 lignes divis?es par 2 pour le PAL. D'o? la formule Fh = Fv * nb_de_ligne / 2 en vid?o entrelac?e ou "100 Hz". La vid?o progressive donne Fh = Fv * nb_de_ligne. Vous pouvez remarquer que la fr?quence horizontale est ?gale entre le 100 Hz et le progressive d'o? la quasi-absence de surco?t sur les t?l?viseurs bi-modes. Quelques chiffres ? avoir en t?te : 15.7 kHz pour l'entrelac?e, 31.5 kHz pour le 100 Hz et le progressif.
3.9.3. La bande passante. C'est le dernier crit?re pour juger de l'acuit? d'un diffuseur. Sur chacune des lignes, il faut afficher 720 points pour le DVD. Pour du PAL en une seconde, il s'affiche jusqu'? 625*720*25 points diff?rents. Comme un point blanc suivi d'un point noir se r?sume ? une p?riode, la bande passante est donc de 625*720*25/2 = 5.625 Mhz. La formule g?n?rale est donc BP = Fh*nb_de_point / 2. Apr?s, r?sumer la succession d'un pixel blanc suivi d'un noir, a un signal sinus n'est pas fid?le : il faut consid?rer le signal ?lectrique correspondant ? un signal cr?neau. Et sans entr?e dans les d?tails, un signal cr?neaux, quelque que soit sa p?riode, pr?sente au niveau des fronts de mont?s un signal dont la fr?quence tend vers l'infini. Donc pour restituer un cr?neau ? 5.7 MHz, il faut un processeur travaillant ? fr?quence largement sup?rieure pour tendre vers le signal originel. Avoir de la marge au niveau bande passante est donc int?ressant pour le piqu? de l'image. La bande passante est un gros crit?re de qualit? : comparer un DVD avec un magn?toscope VHS, le nombre de lignes et d'images par seconde est identique. Seule la bande passante change : elle est donc de 5.7 MHz pour le DVD et 3 fois moindre pour la cassette (2MHz). Si vous regardez un enregistrement PAL sur VHS d'un film en format cin?ma, vous pourrez voir une transition bande noire / image aussi net qu'avec un DVD. Une derni?re remarque, pour juger de la r?solution d'un diffuseur, il ne faut pas confondre nombre de pixels affichables et bande passante. On diffuse une image annonc?e comme ?tant au maximum des capacit?s du vid?oprojecteur. Elle est, supposons, correctement restitu?e. On double la fr?quence verticale pour avoir une image plus stable, et l'on d?passe alors la bande passante maximum de l'appareil : L'image sera alors toujours affich?e mais la d?finition horizontale sera alors r?duite dans le prorata du d?passement. 4. Taille de l'image n?cessaire.
Un des crit?res pour choisir la taille de son image est le principe d'immersion. En fait si l'on veut ?tre au coeur de l'action, il faut que l'angle que repr?sente le champ visuel qui observe l'?cran soit suffisamment grand. Dans les crit?res THX, le spectateur doit former avec la base de l'?cran un triangle isoc?le dont l'angle au sommet est au minimum de 32?. Plus le spectateur s'approchera de l'?cran, plus l'angle grandira, plus l'immersion dans l'action augmentera. La limite est d?finie par la facilit? de suivre l'action de gauche ? droite. Si l'on prend un angle de r?f?rence de 33?, il faut alors avoir un recul ?gal ? 1,5 fois la base de l'image. Imaginez ce que cela fait avec un t?l?viseur 70 centim?tres, m?me pas un m?tre de recul. Par contre avec un moniteur informatique, on est en plein dans ces proportions, est-ce la le secret des Doom-likes sur PC ? c'est pour cela que nous ne sommes nombreux ? ne jurer que par une grande image (et peu de recul). Un vid?o projecteur peut se trouver ? partir de 4000Frs d'occasion, avis aux amateurs.
Le deuxi?me crit?re pour choisir la taille de son image est celui de la d?finition minimum suffisante. C'est-?-dire, quand on regarde une image issue d'un tri-tubes, d'un t?l?viseur, un recul insuffisant mettra en ?vidence le lignage de la source vid?o. Dans le cas d'un projecteur LCD, ce sera la perception des pixels qui sera limitative. Pour effectuer le calcul, il faut d?terminer l'acuit? visuelle de l'?tre humain. Elle est commun?ment admise de 0.3 milliradians. J'ai introduit un facteur de finesse de spot qui tient compte de l'?paisseur de la ligne compar?e ? l'espace qu'elle doit remplir. Un projecteur ? haute r?solution, aura un spot plus fin, et on verra alors des lignes noires entre les lignes du balayages. Pour un vid?oprojecteur SONY VPH 1001, je l'ai estim? ? 4.2 .
Dans
le meilleur des cas, c'est un DVD PAL en 16/9?me : un recul ?gal
? 1,3 fois la base de l'image. 5. Les diff?rentes qualit?s d'une image.
Le rapport signal/bruit, d?note du niveau de noir de la source. C'est-?-dire que l'on fait la comparaison entre le signal maximum que peut fournir l'appareil, et le bruit ?lectrique que fournit l'appareil pendant l'absence de signal. Plus le signal bruit est faible, moins les noirs seront profonds et plus l'effet de neige sera pr?sent.
La d?finition d'une image peut se faire dans le sens de la hauteur et de la largeur. Une grande confusion r?gne entre le nombre de lignes affichables et le nombre de points par ligne.
La Colorim?trie d?note du respect des couleurs de la vid?o vis-?-vis de l'original sur la pellicule argentique. Elle peut ?tre modifi? au niveau de l'?quilibre des couleurs (r?glage de HUE en NTSC uniquement) et au niveau de la saturation globale.
La g?om?trie d'une image est correcte si toutes formes g?om?triques, telles le rond, sont correctement affich?es en n'importe quel endroit de l'?cran (? ce propos, le canon dans lequel appara?t James BOND n'est pas rond ! Demain ne meurt jamais).
La convergence d'une image est correcte si les trois images form?es par le rouge le vert et le bleu se superposent parfaitement en tout point de l'?cran.
La dessus pas de myst?re, le num?rique est un danger pour le naturel de l'image. j'ai mis un an ? regarder des d?monstrations de DVD avant de trouver des configurations qui soit plus belle que le laserdisc. Un premier principe : si on ne peut contourner le num?rique du DVD, il faut interdire tout autre maillon num?rique tel que t?l?viseurs 100 Hz ou doubleurs de lignes douteux. Ensuite, il ne faut pas abuser du r?glage de luminosit? qui est un v?ritable r?v?lateur de pixels. Ensuite, utiliser dans l'ordre la liaison YUV, RVB, YC. Si c'est pour utiliser la liaison composite, autant laisser le diffuseur ?teint (j'exag?re, mais ? peine?). Pour information, j'ai vu un BARCO 508 merveilleux chez MOVIE STORE qui ?tait m?diocre chez les ANNEES LASER de la Bastille. J'ai vu une association BARCO 708 avec un doubleur FAROUDJA sublime chez PRESENCE AUDIO CONSEIL qui ?tait juste bonne chez AUDIO CONCERT. Nombres de vendeurs veulent retoucher les r?glages d'un vid?oprojecteur ainsi que la connectique utilis?e alors qu'ils ne sont que des vendeurs d'enceintes. L'importateur des doubleurs de lignes FAROUDJA me l'a confirm?. 6. Les diff?rentes technologies de diffuseur vid?o.
Ils se divisent en deux parties : premi?rement les mod?les de base en 4/3, et deuxi?mement les mod?les 16/9 ou les mod?les 4/3 avec commutation 16/9. Pour tous utilisateurs de DVD la seconde cat?gorie est incontournable. D'autre part toujours pour les m?mes utilisateurs, les t?l?viseurs ? balayage 100 Hz sont d?conseill?s : en effet leurs processeurs vid?o travaillent de mani?re num?rique. Les images analogiques de base qui ont ?t? num?ris?es pour ?tre stock?es dans le DVD, ont ?t? ensuite reconverties en analogique pour se transporter jusqu'au t?l?viseur, puis de nouveau converties en num?rique pour le traitement 100 Hz et sont une derni?re fois reconverties en analogique pour ?tre diffus?es par le spot du t?l?viseur. Cette double conversion num?rique/analogique est en grande partie responsable de l'image typiquement pix?lis?e que l'on reproche au DVD. A propos des t?l?viseurs 16/9?me, j'entends des vendeurs qui argumente qu'ils offrent 33% d'image en plus qu'un 4/3. A ceux la, je r?pondrais par les deux sch?ma suivants : la surface que repr?sente une image 16/9?me dans une lucarne 4/3 et une image 4/3 dans une lucarne 16/9?me.
Ce que l'on per?oit visuellement s'exprime ainsi de mani?re chiffr?e :
Bien sur au niveau qualitatif, le 4/3 devra disposer d'une commutation 16/9?me pour rivaliser avec son concurrent (pour ce qui est de la diffusion de programme en 16/9?me anamorphique, exclusivement les DVD et certains satellites). Votre choix entre ces deux cat?gories de t?l?viseurs d?pendra donc du fait que vous regardiez beaucoup de programmes 4/3 ou non.
Les projecteurs vid?o se divisent en trois cat?gories : les tri-tubes, les LCD et les DMD (ou autre DLP). Les tri-tubes lorsqu'ils sont exempts de doubleur de ligne travaillent enti?rement en analogique. C'est la source de choix pour une image cin?ma. Les 2 autres technologies bas?es sur la ma?trise du pixel, provoquent le m?me type de d?fauts que les t?l?viseurs 100Hz. Un petit avantage au DMD, ses micro miroirs laissent passer moins de lumi?re dans les noirs que les LCD. Il faudra attendre de longues ann?es avant d'avoir des projecteurs permettant de rivaliser avec les tri-tubes: en effet le DVD ?tant une technologie ? base de pixels, lorsque les premiers appareils de projection auront des matrices ayant le m?me nombre de pixels que la r?solution de base du DVD, et que la liaison entre la lecture du disque, et la matrice d'affichage se fasse sans conversion interm?diaire, c'est ? dire en num?rique on pourra esp?rer un meilleur naturel de l'image. C'est solution est d?j? abord? avec une matrice ? la r?solution largement sup?rieur ? celle du DVD, les effets de moirages sont alors r?duits. De m?me, STAR WARS EPISODE 1 a ?t? projet? dans 4 salles au Etats Unies en projection digital.
120 kf, ils sont fous ! 50 kf ils sont fous aussi ! Rappelez moi quand ils seront ? 5kf et qu'ils n'auront plus des noirs qui soient gris.
Je n'aime tellement
pas ?a que je n'ai rien ? dire là dessus. Un meuble immense,
une luminosit? blafarde, le tout pour le prix d'un tri-tubes.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|